Chapitre IV : La Combattante
Cinq jours avant la déclaration de guerre de la France à la Prusse en 1870, André Léo publie, dans Le Siècle, un article enthousiaste sur la société Revendication des droits de la femme qui est le fruit de son association avec Noémie Reclus, les deux frères Reclus Elie, l’époux de Noémie, et Elisée, mais aussi avec Marie David, La Cécilia par son mariage, institutrice républicaine qui tiendra le secrétariat de l’Association : « …Le succès anime et encourage. Le petit groupe des premiers jours a vu les rangs s’accroître par centaines, et l’œuvre choisie et poursuivie depuis 18 mois est sur le point de se réaliser. Cette œuvre – je l’ai signalée ici déjà – est l’école démocratique. L’école et non pas une école ; car celle-ci doit être dans la pensée de ses fondateurs le modèle des écoles du monde nouveau. […] Le berceau de la démocratie est l’école nouvelle, républicaine dans sa morale, rationnelle dans ses méthodes, enseignant et pratiquant la liberté, l’égalité, la fraternité. […] c’est d’une révolution radicale qu’il s’agit dans les idées, dans les institutions, dans les mœurs, et par conséquent et surtout dans l’éducation. Les partisans de l’égalité de la femme, c’est-à-dire, parmi les démocrates, les plus exempts de préjugés, les plus dégagés de toute routine, devaient comprendre cette vérité. Leur première œuvre est l’école libre, l’école de la raison et de la liberté. Ce sera une école de filles. On objecte contre les droits de la femme son éducation : ils la changent ; ils vont élever des citoyennes -comme il faudrait élever des citoyens. […]Instruite de ses droits, elle saura les faire respecter en se respectant elle-même. »
Elle nomme les professeurs qui enseigneront dans cette école et l’on est impressionné par la qualité de ces enseignants ainsi l’on aurait pu y trouver le géographe Elisée Reclus[1], l’historien Paul Lacombe[2], féministe convaincu qu’André Léo cite dans son livre La Femme et les Mœurs : « Les huit dixièmes des mineurs qui se permettent d’occuper les moments de nos tribunaux, appartiennent à la tribu (des enfants naturels). Elle fournit à la prostitution un bon quart de ses recrues. » (Paul Lacombe. Le Mariage libre) », un musicien Gustave Francolin[3] franc-maçon et réformateur social, et d’autres participants tous convaincus par les idées de l’Association. Son amie Marie David devait y enseigner la comptabilité. Emplie d’espoir elle évoque aussi le projet d’une pétition « pour la réforme de loi du mariage »
Malheureusement la guerre[4] devait mettre fin à ces beaux espoirs.
André Léo était pacifiste, aussi lors de son discours prononcé au Congrès de la Paix le 27 septembre 1871 à Lausanne, elle rappelle dès le début que cette guerre contre la Prusse n’était pas voulue par le peuple : « Le sentiment des maux de la guerre et de leur folie s’était propagé rapidement jusque dans le peuple, et ce sentiment fut pour beaucoup dans la stupéfaction, dans l’indignation, que causa en France la déclaration de guerre du 15 juillet. » et avant de tenter de rallier à sa cause les membres du Congrès, elle met en avant son patriotisme, car patriote elle l’était comme tous les Français à à cette époque[5]
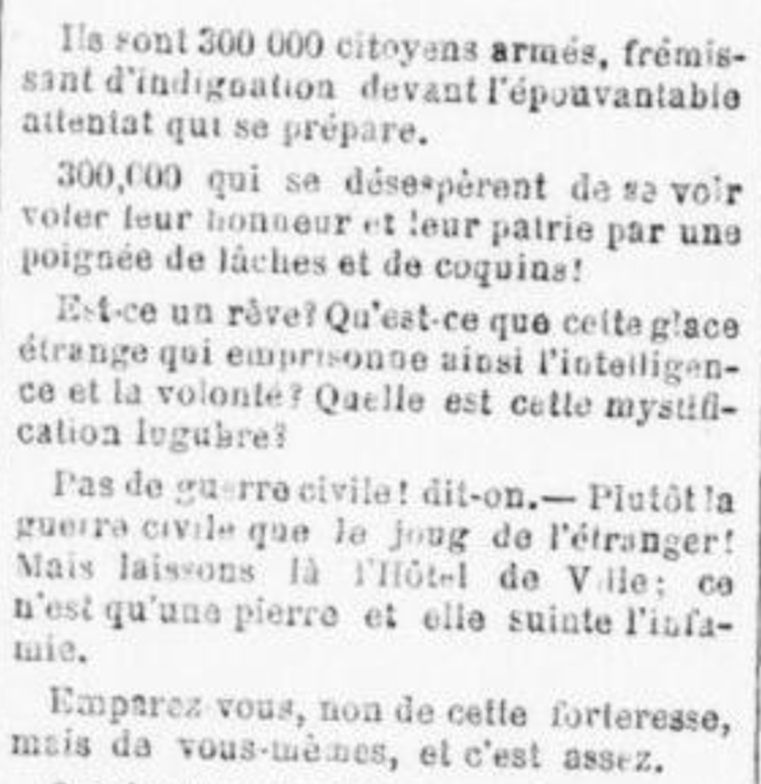
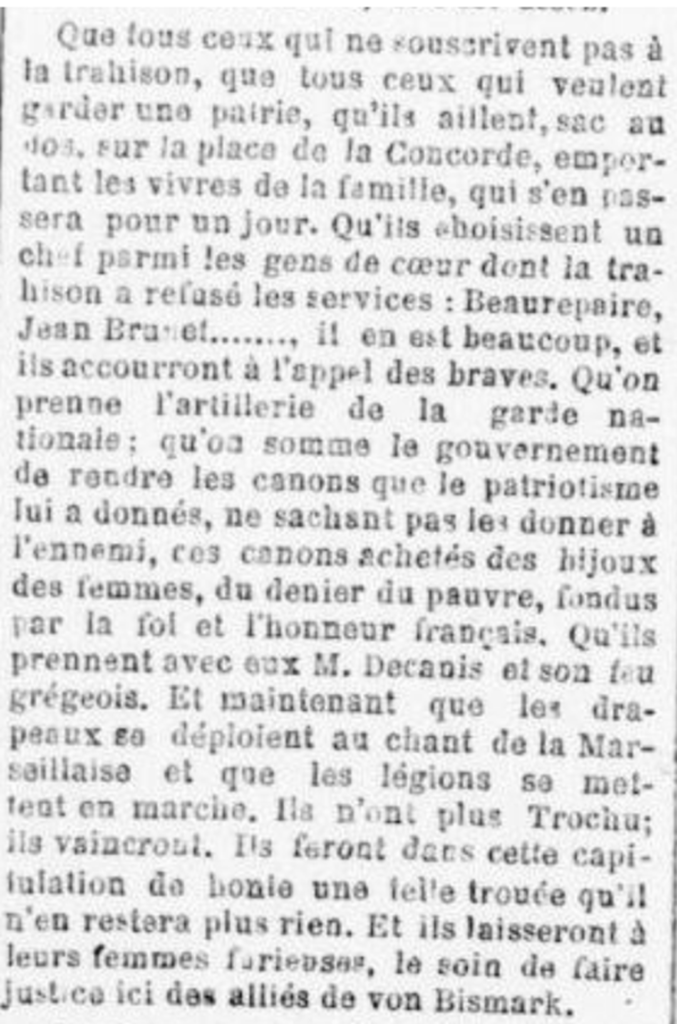
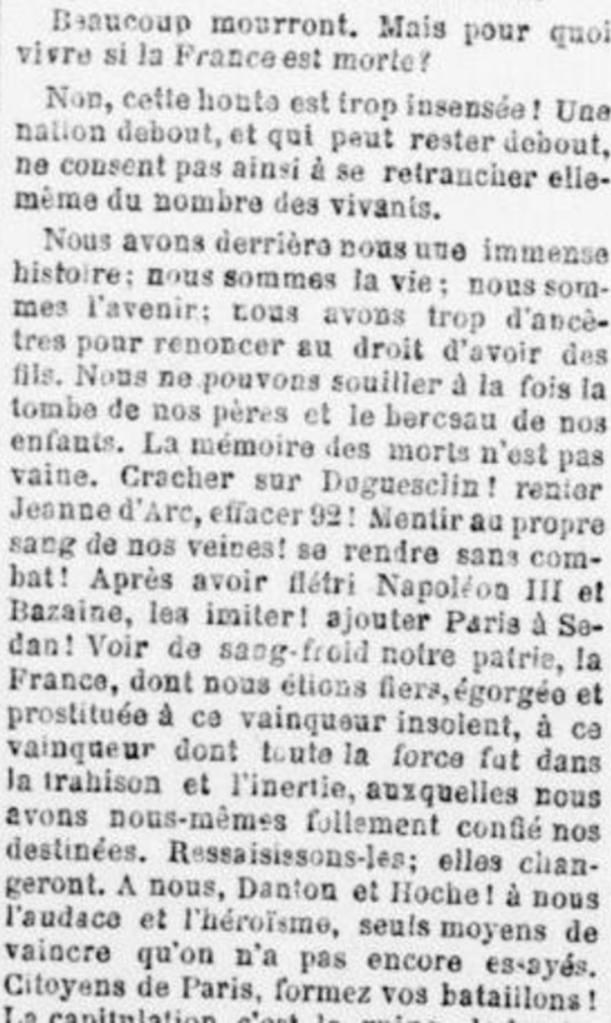
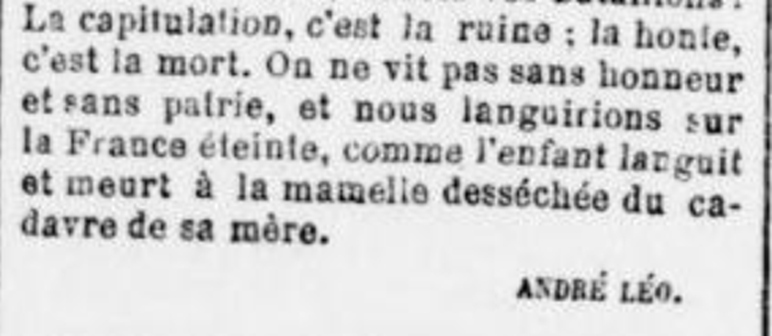
Louise Michel dans ses Mémoires rappelle que pendant le Siège de Paris André Léo, fidèle à la droiture de ses principes et à la liberté, se démène dans l’espoir de sauver l’Alsace : « C’était au temps du siège, avec Mme André L… Nous avions fait appel à des volontaires pour aller, à travers tout, à Strasbourg agonisante, et tenter un dernier effort ou mourir avec elle. Les volontaires en grand nombre étaient venus. Nous traversions Paris en longue file, criant : A Strasbourg ! A Strasbourg ! Nous allâmes signer sur le livre ouvert sur les genoux de la statue, et de là à l’Hôtel de ville où nous fûmes arrêtées, Mme A. L.., moi et une pauvre petite vieille … » Elles ne furent pas incarcérées. André Léo se démène participant avec Ferdinand Buisson, Benoît Malon, Elisée et Elie Reclus entre autres, au journal La République des Travailleurs qui ne connaîtra que six numéros dans lesquels elle écrit des articles pour défendre la République comme dans celui du 4 février : « Que d’un nouveau scrutin sortent des hommes énergiques, portant vraiment en eux l’âme de la France, des hommes qui sachent, parce qu’ils le sentent, que le droit est la force suprême du monde humain ; que la volonté est l’arme indestructible dont l’acier défie les canons, – et la France, fut-elle acculée jusque dans ses bois et ses montagnes, renaîtra plus forte et plus grande, épurée des hontes monarchiques, et républicaine à jamais, car après avoir vu ce que valent les sauveurs, elle aura su se sauver elle-même. » même si la veille dans ce même journal elle déplorait « l’esprit monarchique » qui avait pétri les Républicains aussi bien que les Conservateurs, car pour cette femme issue, rappelons-le, de la bourgeoisie provinciale, la République n’existera pas « tant que de vrais paysans et de vrais ouvriers ne siègeront pas sur les bancs de l’Assemblée nationale. Intelligents et honnêtes, ils pourront se passer de rhétorique ; on sait maintenant à quoi elle sert. »
Elle fustige aussi la religion dans un article du 15 janvier 1871 au titre révélateur le Fétichisme : « C’est cette maladie de l’adoration irraisonnée, du respect irréfléchi, que j’appelle fétichisme. Elle nous est inoculée dès l’enfance, le jour où l’on nous fait mettre à genoux devant les fétiches de nos églises et où l’on nous enseigne que nous sommes créés et mis au monde pour adorer ce que nous ne comprenons pas. Dès lors, elle se répand dans l’esprit comme la jaunisse dans le sang et revêt pour nous certains objets d’un prestige particulier » faisant preuve d’un grand prosaïsme. Elle exprime aussi sa colère et sa révolte contre la condition du peuple lors du Siège de Paris dans le journal du 22 janvier : « Les souffrances, les privations, les tortures de ce long siège, qui les a souffertes jusqu’ici ? Le pauvre, le pauvre seul. Et par pauvres s’entendent tous ceux qui ne sont pas riches, tous les ruinés de la guerre, tous les travailleurs qui depuis des mois n’ont plus de travail. Pour tous ceux-là, 300 grammes de pain, sans autres aliments confortables, qu’ils ne peuvent pas acheter, c’est la mort, je le répète. De quel droit cette condamnation qui, dans le malheur commun, choisit ses victimes ? C’est le peuple qui doit mourir ; c’est le peuple qui paye tout, sous la République comme sous l’Empire. Et pourtant ce n’est pas le peuple qui a décidé la guerre. Ce sont les riches, ce sont les bonapartistes. — Et ce sont eux seuls qui échapperaient aux maux qu’ils ont causés ? »
Son combat est quotidien et pour diffuser ses idées qui sont aussi celles des militants de l’AIT (l’association internationale des travailleurs) elle collabore à de nombreux journaux dont Le Cri du Peuple de Jules Vallès et La Sociale. André Léo, depuis les années 1860, est toujours prête à défendre les causes désespérées ou les causes justes comme le droit à l’association, ancêtre du syndicalisme alors interdit, l’égalité des sexes dans le travail, l’enseignement des femmes, le droit des femmes, la condition des ouvriers, des paysans … Le 4 septembre 1870, André Léo en compagnie de Louise Michel et Benoît Malon se rendent chez le gouverneur de Paris, le général Trochu pour obtenir la grâce de 2 blanquistes condamnés à mort. Et ce même jour, elle adhère au Comité de vigilance de Montmartre[6], crée par Clémenceau, alors maire du XVIIIe arrondissement. Ce comité fut impliqué dans l’évènement à l’origine du soulèvement du 18 mars 1871 : la défense des canons de Montmartre. A ce propos, André Léo, le 8 mai 1871, rappelait au Général Dombrowski, dans un article du journal La Sociale : « Savez-vous, général Dombrowski, comment s’est faite la révolution du 18 mars ? Par les femmes. On avait dirigé de grand matin des troupes de ligne sur Montmartre. Le petit nombre de gardes nationaux qui gardaient les canons de la place Saint-Pierre avait été surpris et les canons enlevés ; on les descendait sur Paris—sans obstacle. La garde nationale, sans chefs, sans ordre, hésitait devant une attaque ouverte. Encore quelques tours de roue, et vous n’auriez jamais été général de la Commune, citoyen Dombrowski. Mais alors, sur la place de l’Abbaye, les femmes, les citoyennes de Montmartre, se portèrent en foule, saisirent la bride des chevaux, entourèrent les soldats, et leur dirent :
— Quoi ! vous servez les ennemis du peuple, vous, ses enfants ! N’êtes-vous pas las d’être les instruments de vos propres oppresseurs ? N’êtes-vous pas honteux de servir des lâches ? Arrêtés tout d’abord par la crainte de blesser les femmes et d’écraser leurs enfants, qui s’attachaient aux roues des canons, les soldats comprirent ces reproches, et ils mirent en l’air la crosse de leurs fusils. Le peuple poussa des cris de joie : les prolétaires, divisés sous différents noms et sous différents costumes, se comprenaient enfin et se retrouvaient. Plus d’armée, partant, plus de tyrannie. Soldats et gardes nationaux s’embrassèrent ; On replaça les canons ; désormais, la confiance, l’enthousiasme, un indomptable courage, remplissaient les âmes, indécises un instant avant. La Révolution était faite. Grâce aux femmes, surtout. Il faut bien l’avouer, et je vous le répète, citoyen Dombrowski, — et vous, grand-prévôt, qui chassez de vos avant-postes les femmes assez dévouées à la cause de la Révolution, pour lui sacrifier leur vie »
Cet épisode de la Commune est confirmé par Gaston da Costa[7] dans La Commune vécue : Les femmes leur crient : – Est-ce que vous tirerez sur nous ? sur vos frères ? Sur nos maris ? sur nos enfants ?
Les soldats sont de plus en plus hésitants. Les officiers les menacent. Ils sont entourés et injuriés par les femmes.
Enfin les soldats du 88″ de ligne mettent la crosse en l’air.
Alors ce sont des cris frénétiques de « Vive la ligne ! A bas Vinoy ! A bas Thiers ! »
[1] C’est sous la IIIe République, après la défaite et la perte de l’Alsace Lorraine, que ce patriotisme donnera naissance au nationalisme, le gouvernement y contribuera par le biais de l’Instruction Publique et des hussards noirs de la République qui obéissaient à la consigne de Jules Ferry qui en 1880 déclarait : « Il importe à une société comme la nôtre de mêler sur les bancs de l’école, les enfants qui se trouveront plus tard, mêlés sous le drapeau de la Patrie. » et les pédagogues comme A. Lorrain d’écrire : « Nos écoliers seront tous des soldats; dans quelques années, ils auront à servir et, s’il le faut, à défendre leur patrie. […] il faut qu’ils sachent comment nos pères ont aimé, servi et défendu la patrie. C’est pour aider les instituteurs à obtenir ce résultat que nous leur présentons ce petit livre. Le maître rattachera sa leçon de patriotisme à cette lecture, et il trouvera dans son cœur et dans son amour du pays l’accent qu’il faut pour émouvoir un jeune auditoire. » Et surtout n’oublions pas que le 6 juillet 1882 par décret, jules Ferry créa les bataillons scolaires.
[1] A propos d’Elisée Reclus le critique Robert de Bonnières écrivait : « L’œuvre de M. Elisée Reclus est puissante, originale et facile. C’est un livre de haute science qu’on a voulu que chacun pût lire. M. Reclus, qui est un grand inventeur en géographie, ne se contente pas de décrire les régions comme Strabon ou Matte-Brun. Il en montre la formation en même temps que la structure et comment le feu et l’eau dessinèrent, à travers les âges, la figure du monde. Et quand cela est fait ; quand il a montré le sol en proie à la vie, il nous enseigne avec une grande sagacité les rapports qui se sont établis entre ce sol et l’homme qui l’habite. » En désaccord avec ses idées politiques, il rend malgré tout hommage non seulement au géographe mais à la bonté de l’homme : « M. Reclus est aussi doux et humain qu’un fanatique peut l’être. Il ne touche, dit-on, qu’avec répugnance à la nourriture animale, et ne vit guère que de légumes et de lait. Il ne tue pas les insectes. Il met délicatement dans un cornet les mouches importunes et les envoie bourdonner dehors. C’est un homme petit, trapu, qui parle peu et qui a l’air très énergique. » Et malgré ce qu’il considère comme folie, il respecte cet homme droit : « Cette sorte de folie est installée dans un esprit supérieur. Voilà ce que nous croyons la vérité sur cet homme singulier. Libre et désintéressé, nous avons pu parler haut et ferme de M. Elisée Reclus. Mais quel homme aujourd’hui au pouvoir a seulement le droit de le regarder en face ? » (Mémoires d’aujourd’hui vol.3 /1883-1888)
[2] Paul Lacombe (1834-1919) : Historien, archiviste, précurseur de l’histoire évènementielle
[3] Gustave Francolin 1835-1899 : Ingénieur civil, enseignant à la société d’instruction élémentaire (la plus ancienne association laïque d’enseignement primaire), directeur de presse, musicien, républicain converti au socialisme dans après la Commune à laquelle il ne participa pas, il fonde en 1888, l’Ecole de sociologie. Louise Michel l’a évoqué dans La Commune : « Nous avions pour cela, comme complice M. Francolin, de l’instruction élémentaire, qu’à cause de sa ressemblance avec les savants du temps de l’alchimie et aussi par amitié nous appelions le docteur Francolinus. Il avait fondé, presque à lui seul, une école professionnelle gratuite rue Thévenot. Les cours y avaient lieu le soir. Celles d’entre nous, qui en faisaient pouvaient ainsi se rendre rue Thévenot après leur classe, nous étions presque toutes institutrices. »
[4] Cette guerre fut voulue par l’Impératrice et ses partisans. Prévost-Paradol, ministre plénipotentiaire de France aux Etats-Unis désespéré par la nouvelle confiait au Comte d’Hérisson, avant de se suicider : « […] vous serez écrasés en France. Croyez-moi : je connais les Prussiens ; Nous n’avons rien de ce qu’il faut pour lutter avec eux. Il nous manque des généraux, des hommes et du matériel. Nous serons broyés. […] La France sera en révolution avant six mois. L’Empire par terre. »
[5] C’est sous la IIIe République, après la défaite et la perte de l’Alsace Lorraine, que ce patriotisme donnera naissance au nationalisme, le gouvernement y contribuera par le biais de l’Instruction Publique et des hussards noirs de la République qui obéissaient à la consigne de Jules Ferry qui en 1880 déclarait : « Il importe à une société comme la nôtre de mêler sur les bancs de l’école, les enfants qui se trouveront plus tard, mêlés sous le drapeau de la Patrie. » et les pédagogues comme A. Lorrain d’écrire : « Nos écoliers seront tous des soldats; dans quelques années, ils auront à servir et, s’il le faut, à défendre leur patrie. […] il faut qu’ils sachent comment nos pères ont aimé, servi et défendu la patrie. C’est pour aider les instituteurs à obtenir ce résultat que nous leur présentons ce petit livre. Le maître rattachera sa leçon de patriotisme à cette lecture, et il trouvera dans son cœur et dans son amour du pays l’accent qu’il faut pour émouvoir un jeune auditoire. » Et surtout n’oublions pas que le 6 juillet 1882 par décret, jules Ferry créa les bataillons scolaires.cette époque : « La France, abandonnée à l’étranger ; les trahisons et les malversations de 1870, l’armistice et la paix de 1871 … »
[6] Ce comité fut dirigé par Sophie Poirier (1830-1879). Elle avait fondé en 1868 un atelier coopératif pour la confection d’uniformes qui employait entre 70 et 80 ouvrières mais faute de commandes, il ferma le 10 mars 1871. 8 jours plus tard, à la proclamation de la Commune, Sophie Poirier s’engagea comme ambulancière. Jugée et condamnée en mars 1872, elle finit sa vie en prison.
[7] Gaston da Costa : 1850-1909 : Blanquiste puis communard, condamné à la déportation. Rapatrié en 1880, il adhère au boulangisme dit de gauche et adhère au Comité central socialiste révolutionnaire. Lors des élections municipales de 1896, il déclarait : « Socialiste nationaliste, je déclare que, fidèle au drapeau sous lequel j’ai toujours combattu, et sans m’arrêter aux conceptions purement platoniques d’un internationalisme aujourd’hui irréalisable, je continuerai à défendre le travail national et les travailleurs français contre la concurrence de la main-d’œuvre étrangère sous toutes ses formes. Non seulement je veillerai à ce que, sur les chantiers municipaux, l’emploi de la main-d’œuvre étrangère soit strictement maintenu dans les limites déjà trop larges de la loi ; mais encore, je ferai tous mes efforts pour qu’une taxe municipale vienne atteindre les travailleurs étrangers qui nous font à Paris et dans la France entière une concurrence déloyale, qui échappent d’autre part aux plus lourdes charges fiscales et qui, enfin, ne payent pas chez nous cet impôt que la situation de l’Europe rend encore nécessaire et qu’on appelle l’Impôt du sang. »
A suivre …
Tous droits réservés : Jeanne Bourcier