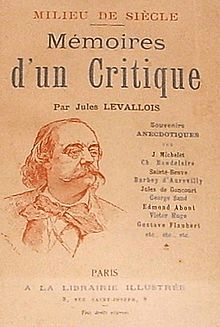Prosper Levallois, aujourd’hui allègrement oublié, fut un homme de lettres qui débuta comme secrétaire de Sainte-Beuve et qui devint, à partir de 1859, critique reconnu et apprécié au journal L’Opinion Nationale. Il connut tous ceux qui firent la seconde moitié du XIXe siècle. Erudit, discret et réputé causeur fin et agréable, il a laissé ses Mémoires, Mémoires d’un critique, véritable bijou à lire. Il a, avec la plus grande sincérité, tenté de donner une image attachante de ces hommes célèbres encore aujourd’hui. En ce qui concerne Victor Hugo, il n’est pas acerbe, comme certains ont pu l’être, mais sa franchise donne une image d’un Hugo cabotin.
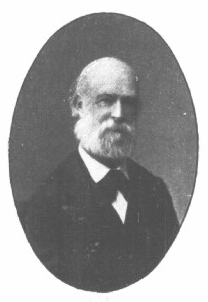
Ce souvenir remonte à 1870, lors du Siège de Paris. Hugo est revenu de Guernesey, tous attendent soutien et réconfort du grand homme : « Victor Hugo et Edgar Quinet rentrant de l’exil, étaient venus s’enfermer avec nous dans Paris. Je n’ai pas la moindre envie de plaisanter. C’était bien un renfort, et le plus précieux qui nous pût parvenir, le plus propre à nous rehausser le coeur. Nous avions toujours suivi avec une fidélité passionnée cette littérature de l’exil. Dans l’ Opinion Nationale, où l’on avait pleine confiance en moi, je n’avais laissé passer aucune production du maître sans en parler avec autant de sympathie que de respect. Une correspondance s’était établie entre nous à ce sujet, et je puis dire que les lettres de Hugo sortaient pour la plupart du cadre banal où trop souvent il a coulé ses félicitations.
Quand je connus son arrivée à Paris, j’allai porter ma carte au pavillon de Rohan où il s’était momentanément établi. Je reçus peu de jours après une lettre où le grand poète me disait qu’il désirait connaître personnellement le critique si bienveillant de son oeuvre, et il concluait en m’invitant à dîner frugalement le lendemain ou le surlendemain. Comme on le pense bien, je ne manquai pas au rendez-vous, et je fus très cordialement accueilli au pavillon de Rohan. Je trouvai chez Victor Hugo une très grande bonhomie, une simplicité de conversation et d’allures qui étonnaient au premier abord. Il n’avait rien d’Olympien, quelque chose plutôt de familier et de paternel. Dès le premier mot il me demanda si j’avais des enfants. Ce lui fut un thème pour s’étendre sur cette matière dont il aimait à parler et où il excellait.
Au dîner, je fus place auprès de Mmc Drouet, la célèbre Juliette de jadis, belle encore sous ses cheveux blancs, très distinguée, causant avec finesse et répondant avec tact. Charles Hugo arriva au milieu du repas. Son père le gronda fort d’avoir manqué le potage, qu’il regardait comme la partie la plus substantielle et la plus nécessaire de la nourriture. Il lui en fit apporter une bonne assiettée et voulut qu’il la mangeât séance tenante. J’avais lu autrefois dans l’Artiste quelques jolies pages de Théophile Gautier sur la manière dont se nourrissaient les écrivains illustres de notre temps, et j’y avais noté ce détail, que Hugo, gastronome formidable, se contentait pour tout le repas d’une seule assiette où venaient se succéder tous les mets. Ce jour-là je ne constatai rien de pareil, mais je pus voir que l’appétit du maître s’était maintenu à la même hauteur; il fit disparaître en peu de temps une belle quantité de macaroni. Après quelques paroles graves et qui s’imposaient sur la situation, il donna cours à son humeur assez facétieuse et se hasarda jusqu’au calembour. Il nous raconta que pendant la guerre de 1859, une bonne femme de Jersey lui avait appris que les autruches avaient battu les sardines, voulant parler d’un avantage obtenu par les Autrichiens sur les Sardes. Cela le divertissait beaucoup; il avait le rire facile.
Vers la fin du repas, quelqu’un fit demander Mme Charles Hugo. Elle sortit, rentra presque aussitôt c’était un solliciteur, un pauvre. La jeune femme se pencha vers l’oreille de son beau-père et lui murmura quelques mots de pitié touchante que j’entendis distinctement. IIugo ouvrit son porte-monnaie et en tira, autant que je m’en souviens, une pièce de vingt francs, que sa bru alla remettre sur-le-champ au destinataire. Quelques personnes vinrent pendant la soirée, mais l’entrain relatif du diner ne se soutint pas au salon. Les nouveaux arrivants étaient de jeunes littérateurs, des débutants poètes, qui venaient contempler une idole et l’encenser. Une sorte de
cérémonial s’établissait, qui arrêtait l’élan et glaçait les paroles. Je trouvai la même étiquette aux visites suivantes, ce qui, malgré le bon accueil que je recevais, me fit les espacer de plus en plus. »